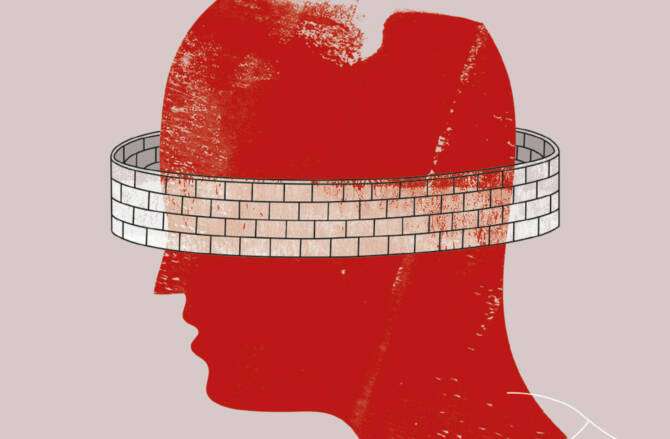Paru aux Éditions Somme toute / Le Devoir en octobre dernier, l’ouvrage collectif Le Devoir de Philo: Démocratie, liberté et politique, nous présente différents enjeux sociaux et politiques, et ce, à travers le regard de philosophes, allant de Jean-Jacques Rousseau et Charles Comte, jusqu’à Michel Foucault et Chantal Mouffe.
Revue du texte Le retour en force de la morale du ressentiment de Jacques Senécal.
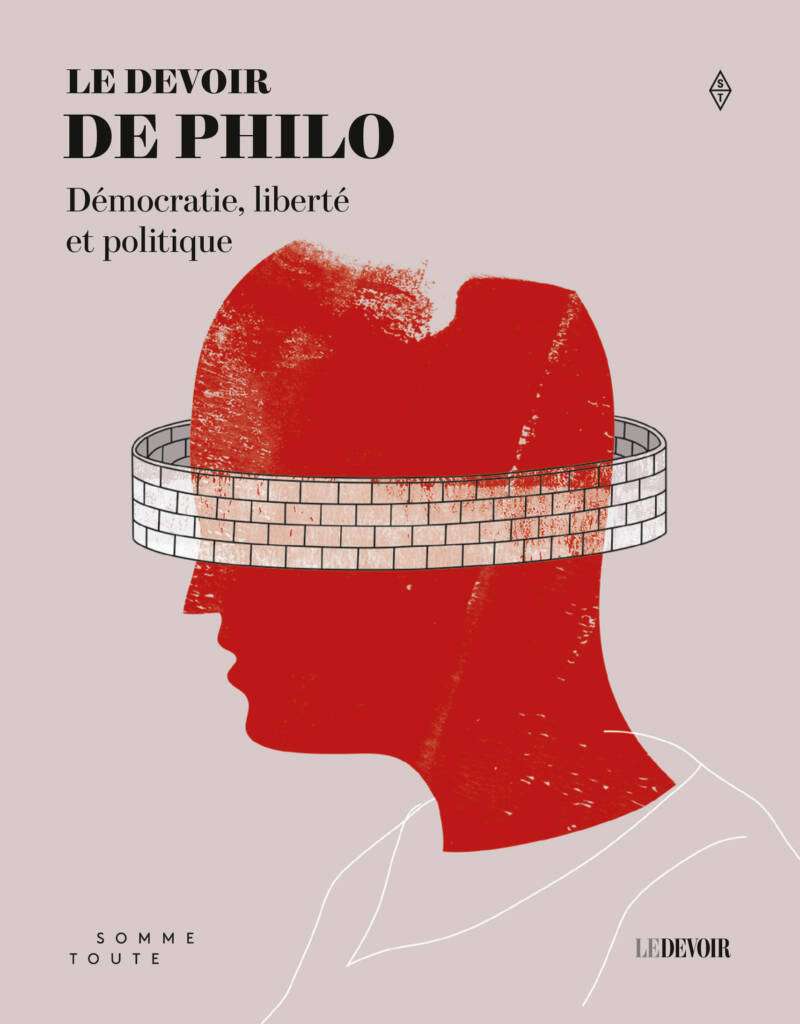
Connaissez-vous la mauvaise blague du prêtre catho, de l’intellectuel pédant et du hipster qui s’achètent un château ? Non ? Comptez-vous chanceux : de toute évidence, vous n’avez jamais eu à visiter le Château des Vampires, ce lieu absolument misérable où s’aventure pourtant (presque) l’essayiste Jacques Senécal dans son texte « Le retour en force de la morale du ressentiment ».
« [U]ne attitude bien-pensante qui, tout en invoquant la défense des droits de la personne et le libre-arbitre, sécrète de l’intolérance et de la culpabilité ». Difficile en effet de ne pas penser ici à Exiting the Vampire Castle, l‘essai phare du penseur britannique Mark Fisher, publié il y a de cela presque dix ans. Car, à l’instar du regretté critique marxiste, Jacques Senécal semble lui aussi s’inquiéter d’un vraisemblable retour à la mode de ce moralisme, culpabilisant et essentialiste, qui a toujours fait la marque de l’Église catholique. « Quel est ce culte de la victime qui nous assaille ? Quelle est cette nouvelle morale ? » Pour répondre à ces questions, l’auteur québécois ne se gêne pas pour convier le spectre de Nietzsche à une petite excursion en périphérie du Château, lui réservant même le prestigieux rôle de guide philo-touristique.
Diagnostiquant un premier malaise, celui de l’individu post-moderne cherchant partout, mais ne trouvant nulle part un remplaçant à la figure assassinée de Dieu, Senécal semble surtout voir dans ce retour du moralisme une tentative de lutte contre le vide ― ou à tout de moins, un effort de négation de celui-ci. Parce que « l’homme […] tolère mal [la mort de Dieu] » et que la vie est une tragédie « dure et mortelle », l’individu d’aujourd’hui tenterait donc à nouveau de se construire « un autre monde » ; un monde séculaire, cette fois, mais où il serait tout de même possible de déléguer à une force-plus-grande-que-soi la fonction/responsabilité du jugement moral. Et le mariage d’apparence contradictoire qui apparaît alors au grand jour, soit celui entre un « humanisme théorique » et la pratique de vieux rites religieux tels que l’ex-communion et l’auto-flagellation, n’est rendue possible que parce que l’humanisme, comme le souligne Senécal, n’y est ici que théorique : derrière la prétention de défendre les groupes et individus les plus marginalisés de la société, on s’accapare l’énergie des mouvements comme le féminisme et l’anti-racisme afin de nourrir ce que l’Américaine Angela Nagle qualifie dans son livre Kill All Normies de véritable économie de la vertu.

Afin de vaincre la « profonde tristesse » inhérente à une telle marchandisation du ressentiment ― laquelle implique naturellement un jeu à somme nulle où le bonheur pour soi ne peut se réaliser qu’en échange d’une destruction totale de celui de l’autre ―, l’auteur identifie comme principal mécanisme d’adaptation une certaine « défaillance de la faculté de l’oubli ». Pour lui, comme pour Nietzsche, l’éternelle (re)digestion de l’acte dont se désole la victime empêcherait donc celle-ci de « passer à autre chose » ; de se faire tributaire d’un futur libre de ces mêmes souffrances.
De la même façon qu’il serait aujourd’hui plus facile, selon les philosophes Frederic Jameson et Slavoj Žižek, d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme, le souffrant identifié ici par Senécal/Nietzsche serait donc lui aussi tout à fait incapable d’imaginer une alternative à la souffrance, celle-ci s’étant naturalisée dans son esprit au point de s’ériger en un inébranlable statu quo de la misère. L’absence de souffrance lui étant devenue d’apparence inconcevable, la victime peut au moins se réconforter dans son projet de redistribution plus égale du malheur. La social-démocratisation de la souffrance, donc, à défaut de pouvoir concevoir un véritable socialisme du bonheur.
Si le retraité professeur de philosophie identifie correctement les contours de cette « nouvelle morale », celui-ci ne s’approche toutefois pas assez près du Château pour en démystifier vraiment les configurations. Le problème qu’il décrit semble flotter dans le vide comme un effluve (ré)apparu spontanément. Les particules qui lui donnent son odeur nauséabonde ne sont jamais identifiées, pas plus que ne le sont les différentes structures qui en permettent la libre circulation. Cela découle en partie du fait que Senécal ne s’attarde ici que sur les locataires qui habitent le Château des Vampires ; ceux et celles auprès de qui le prêtre accusateur et culpabilisant parvient à institutionnaliser la « bonne morale ». Mais, le prêtre lui-même ― tout comme l’intellectuel et le hipster qui sont avec lui les autres co-propriétaires du Château ― ne sont jamais évoqués par l’auteur. Pas plus d’ailleurs que ne le sont les forces du Capital qui en détiennent pourtant l’hypothèque. Or, pour Fisher, le modus operandi des adeptes du Château des Vampires ne consiste pas simplement à « convertir la souffrance des groupes les plus marginalisés en capital [social personnel] », mais aussi à récompenser ceux capable d’identifier avant quiconque de nouvelles formes d’oppression, jusque-là mystérieusement indiscernables (et ce, même si d’une gravité apparemment sans nom). C’est l’esprit de l’intellectuel pédant qui entre ici en jeu, appuyé toujours par le désir du hipster d’être considéré par l’Autre comme maîtrisant tout à fait les codes et les pratiques les plus branchées.
Derrière la simple apparition de cette nouvelle trinité, se cache aussi un dessein ; celui de répondre au problème posé par la (relativement récente) pacification des relations entretenues par les partis politiques traditionnellement de gauche à l’endroit du Capital (ou, pour reprendre la formulation de Mark Fisher : « que peuvent faire [le petit et le grand bourgeois] afin de maintenir leurs privilèges économiques tout en apparaissant toujours comme des victimes et/ou des opposants du système ? ») Si la pensée de Nietzsche peut nous éclairer sur la nature de l’humain et sur les origines philosophiques de ses pulsions moralisatrices et revanchardes, manque encore ici le moteur qui en explique la récente prolifération, soit ce à quoi Angela Nagle fait allusion lorsqu’elle parle d’ « économie de la vertu ».
Parce que cette économie se soustrait à celle du libéralisme, dont elle adopte aussitôt les formes et les instincts, l’économie de la vertu ne peut évidemment fonctionner que dans un contexte où la valeur de la ressource est déterminée par sa rareté : c’est le deuxième problème que vient régler ici le Château des Vampires, soit comment honorer le mode compétitif/divisant du capitalisme, et ce, afin d’éviter la construction d’un bloc solidaire qui pourrait en venir à menacer éventuellement son existence. Afin d’assurer la rareté de la vertu, laquelle est la ressource de cette économie, il devient donc naturel de chercher de plus en plus activement à chasser les occupants les moins « méritants » du Château. Cela explique d’ailleurs pourquoi les reproches de l’intellectuel et les sévices du prêtre tendent plus souvent qu’autrement à viser leurs propres adeptes : plutôt que d’attaquer les structures et les élites réactionnaires qui sont les réels ennemis du progrès, on s’attaque à l’individu qui, de par sa maladresse ou de par sa simple incapacité à rester aux faits des nouvelles pratiques/attitudes/paroles nouvellement proscrites, se montre indigne du nom de son église.
En s’assurant ainsi qu’un nombre toujours un peu plus restreint d’individus se sente partie prenante du projet progressif ― ou ait envie de le rejoindre ―, il va sans dire que le Château des Vampires représente un investissement de choix pour les élites et les bénéficiaires du capitalisme. Car, comme le demandait rhétoriquement Mark Fisher dans son essai : « [P]ourquoi le [capitalisme] serait-il inquiété par une « gauche » qui remplace la politique de classes par un individualisme moralisateur et qui, loin d’engendrer la solidarité, propage la peur et l’insécurité ? »
En conclusion, si celle de Jacques Senécal selon laquelle il faudrait simplement dire « [a]dieu [au] discours victimaire » puisqu’il y a, après tout, « autant de sagesse dans la douleur que dans le plaisir », paraît si peu convaincante, c’est surtout parce qu’elle semble réduire le problème de la morale culpabilisante à une simple fétichisation de la souffrance. Or, les bénéfices de gratification sociale liés à l’exercice de cette « nouvelle » morale (et ce, plus particulièrement sur les réseaux sociaux) sont bien réels et semblent par ailleurs indiquer que, derrière ce nihilisme Nietzschéen, se cache surtout un puissant désir d’appartenance dont se nourrissent les prêtres du Château. Reste seulement à voir combien de temps il faudra à la gauche pour réaliser que le moralisme est toujours, en fin de compte, une stratégie perdante.
À cet effet, elle n’aura d’ailleurs qu’à demander aux conservateurs qui ont, pendant plus de quatre décennies, tenté sans succès de regagner leur hégémonie culturelle d’antan en se positionnant comme seuls défenseurs de la bonne vertu.